Dès l’âge de huit ans, j’ai aimé taper à la machine à écrire. Je n’ai cessé de les collectionner, jusqu’à mon premier ordinateur, un Amstrad vendu avec son imprimante – une révolution, alors. Quel plaisir de pouvoir corriger son texte sans tout ressaisir ! Ensuite, mon premier Mac : un Mac 128, offert par une cliente qui n’en avait pas l’usage (une disquette pour charger le système, une autre pour charger Word, qui pesait en tout et pour tout ses 500 Ko, une dernière pour enregistrer son document). Avec mon premier portable, découverte de la vie d’écrivain nomade : ne plus être cantonné dans son bureau, distinguer enfin l’écriture travail de l’écriture passion. Avec le MacBook Air (le premier modèle, je n’ai pas su attendre), je me suis mis à écrire partout, à tout bout de champ : dans une salle d’attente, sur une banquette du métro, à une terrasse, contre le lit d’une de mes filles qui peinait à s’endormir (cette extrême mobilité m’a amené à me consacrer pour quelques minutes à la réécriture d’un ou deux paragraphes, pris souvent au hasard, ce qui a changé mon regard sur mon travail, comme si cette perspective inédite réclamait la justification de ces passages et, de là, du tout). Avec le tout dernier, réactif (prendre une note sans attendre), lumineux (enfin écrire dans son jardin quand il ne pleuvine pas) et endurant (dix heures avec juste la sauvegarde permanente en WiFi), j’avais l’outil idéal en main.
Mais, outre ces aspects pratiques, j’ai développé un rapport singulier avec l’écran. Certains écrivent debout ou se relisent à haute voix ; aussitôt l’écran levé, je suis déconnecté du reste du monde : il n’y a plus que ce livre qui compte. Ouvrir le capot, c’est comme rejoindre ma tour d’ivoire, ou laisser tomber le masque : je suis tout entier dans l’écriture.
Vulnérable
Pourquoi tous ces mots sur mes petites manies ? Parce que j’en mesure le grand manque : le 18 mai, quelqu’un est entré chez moi, une minute ou deux, et a dérobé cet ordinateur que j’avais laissé en évidence, puisque j’étais dans une autre pièce…
Maniaque des sauvegardes (l’Amstrad s’éteignait inopinément plusieurs fois par jour), je n’ai rien perdu de mes textes. J’ai juste perdu mon outil d’écriture – et, avec lui, de mon entrain, de mon allant, de la joie d’ajouter une page.
Alors, certes, j’ai accès à d’autres postes de travail. Et je passe, effectivement, d’un ordinateur à l’autre, et même, comme actuellement, à une tablette d’emprunt. Je continue d’écrire, un peu. Seulement, je suis dans un costume trop étroit et qui a l’odeur d’un autre. Certes, à force de concentration, les paragraphes s’additionnent, mais ce n’est pas ça. J’ai le sentiment de produire du brouillon, du provisoire, et j’attends d’y revenir avec mon nouveau portable.
Tiens, oui : pourquoi ne pas nous en avoir racheté un autre ?
Bon, les 10 000 exemplaires du Vaisseau ardent ont produit une année de loyer, ce qui n’est déjà pas si mal quand on se penche sur l’économie de l’écrivain. Mais, reste l’assurance. Laquelle prévoit les intrusions clandestines. J’ai donc fourni le rapport de police, le plan et les photos du trajet éclair du voleur, la vue évidente du matériel volé du bout du couloir, rappelé mon ancienneté d’au moins vingt années sans sinistre, et l’activité exercée avec cet ordinateur.
Oui, mais… Si je mentais ?
Négligeable
Le service technique de mon assureur pense que je suis sincère et a remis un avis favorable ; après un mois de délibération, la direction, qui tranche en dernier ressort, a jugé que non. Indemnités refusées.
Un voleur m’a fait mesurer combien j’étais vulnérable, un assureur combien j’étais négligeable.
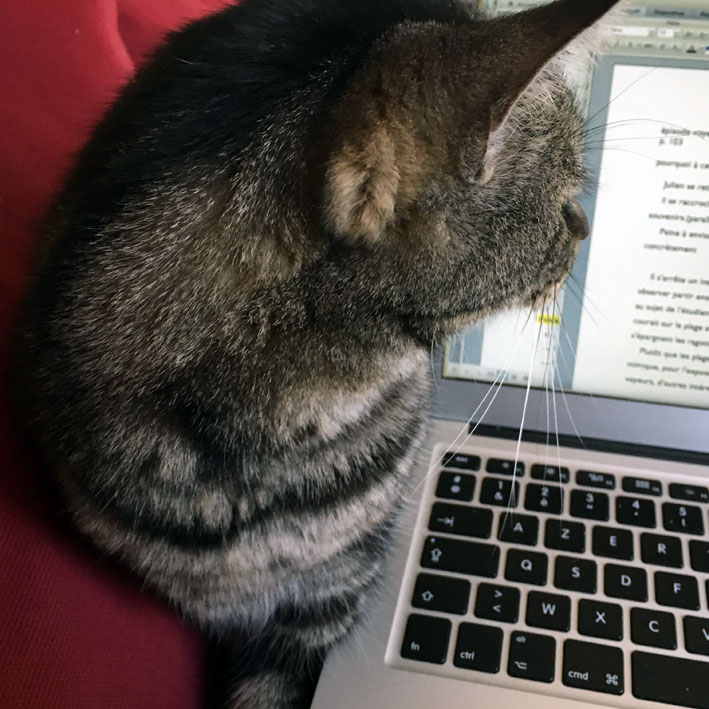
Mon chat aussi est concerné…